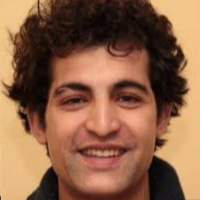Séance académique du 5 février 2026, 14h00 - 18h00
En présentiel : amphithéâtre des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de médecine (Paris 6e)
En visioconférence : connexion Zoom : https://us06web.zoom.us/j/83407226042
Présidence du Dr vétérinaire Jean-Lou MARIÉ
I - PARTIE PUBLIQUE
14h00 – 14h10 : Mot d’accueil du Président
Séance thématique
Actualités sur la dermatose nodulaire contagieuse des ruminants
14h10 : remise de médailles de l’AVF à des vétérinaires particulièrement engagés dans la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse en France
14h20-14h30 : Présentation de la séance
Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX, coordinatrice (AVF, ENVA)
14h30-15h : Actualités sur les capripoxviroses des ruminants dans le monde
Dr Vét. Adama DIALLO (AVF, ex-CIRAD, ex FAO/AIEA)
15h00-15h30 : Bilan 2025 de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse en France
Dr Vét Olivier DEBAERE (DGAL)
15h30-16h00 : Bilan 2025 de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse en Catalogne
Dr Vét Marta DORDAS PERPINYA (ENVA)
16h-16h30 : diagnostic de laboratoire de la dermatose nodulaire contagieuse : outils disponibles et perspectives
Dr Bertand SAUNIER (AVF, Institut Pasteur de Paris)
16h30-17h : Identification de la pseudodermatose nodulaire en France
Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX (AVF, ENVA)
II - PARTIE RESERVEE AUX MEMBRES
17h15 : Approbation de comptes rendus, Questions diverses
Annexe : Résumé des communications
Editorial
Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX, coordinatrice
Conscients que la crise de la DNC allait enfin être résolue après le mois de janvier, il était important de présenter une synthèse des différents aspects de cette maladie exotique qui nous a tous surpris en juin 2025. En premier lieu Adama Diallo nous présentera les aspects épidémiologiques de ces capripoxvirus d’origine africaine qui ont envahi depuis deux décennies de nombreux territoires en particulier l’Asie. Puis notre confrère Olivier Debaere, qui a dû gérer cette crise devenue médiatique voire politique, nous démontrera que la réglementation européenne est efficace pour éviter la progression du virus (à la condition de l’appliquer sérieusement !). Marta Dordas Perpinya témoignera ensuite de son expérience réussie en Catalogne. Bertrand Saunier soulignera les difficultés du diagnostic sur le terrain pour détecter les animaux en incubation. Enfin cela nous a permis de décrire une pseudodermatose nodulaire contagieuse due à un herpèsvirus dans le contexte du diagnostic différentiel de la DNC.
Actualités sur les capripoxviroses des ruminants dans le monde
Dr Vét. Adama DIALLO - AVF, ex-CIRAD, ex FAO/AIEA
La variole ovine ou clavelée, la variole caprine et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) des bovins sont des maladies contagieuses causées par trois virus distincts mais très apparentés et formant le genre capripox dans la famille des Poxviridae. De ces trois maladies, la plus ancienne est probablement la variole ovine car elle serait connue depuis le IIe siècle après J.-C, en Asie Centrale. Quant à la variole caprine ; elle aurait été décrite pour la première fois au Norvège en 1879. A ce jour, ces deux maladies persistent toujours en Asie, au Proche et Moyen Orients et en Afrique avec des incursions sporadiques dans la partie sud de l’Europe (Grèce, Balkans et Espagne). En revanche la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) des bovins serait d’origine Africaine. Décrite pour la première fois en 1929 en Zambie, cette maladie est restée confinée pendant longtemps en Afrique Australe. De ce berceau, elle est remontée insidieusement vers le nord du continent, puis à partir du début des années 1990s elle a émergé au Moyen Orient, en Asie et dans une partie de l’Europe du Sud. Si pour les varioles des petits ruminants la transmission de la maladie se fait essentiellement par contact, les insectes piqueurs jouent un rôle important dans la diffusion du virus de la DNC. Les outils d’épidémiologie moléculaire permettent aujourd’hui un suivi précis de virus dans les différentes régions affectées et on distingue aujourd’hui trois groupes de virus de la DNC, l’un deux, décrit pour la première en 2017 en Russie, est le résultat d’une recombinaison entre la souche vaccinale Neethling et des souches sauvages locales. Le contrôle de ces maladies repose sur l’utilisation de vaccins atténués vivants avec, pour les zones d’émergence, la mise en place de mesures sanitaires draconiennes : restriction des mouvements d’animaux et abattage des animaux sensibles dans les élevages affectés.
Bilan 2025 de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse en France
Dr Vét Olivier DEBAERE - Directeur de crise/Directeur de projet Epizooties à la DGAL
La crise de la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) en France a débuté avec la détection du premier cas positif le 29 juin 2025 (Savoie), le dernier cas à date ayant été confirmé le 2 janvier 2026 (Ariège). Au total, 117 foyers de DNC ont été confirmés, pour 82 élevages répartis dans 11 départements (dont 76 foyers pour les seules Savoie/Haute-Savoie), conduisant au dépeuplement de 3518 bovins et la mise en place de 6 zones réglementées : Savoie/Haute-Savoie, Rhône, Pyrénées-Orientales, Jura-Doubs, Ain et Occitanie.
Dans ces zones réglementées, des restrictions encadrées de mouvements ont été prescrites et des contrôles renforcés ont été effectués.
La campagne de vaccination a été mise en œuvre dès le 18 juillet grâce aux doses mises à disposition gratuitement par la Commission européenne depuis le stock disponible de la banque européenne d’urgence (en Afrique du Sud). Ensuite, les doses nécessaires pour poursuivre la campagne de vaccination obligatoire dans les zones réglementées et les zones vaccinales ont été achetées par la France à un laboratoire européen (Pays-Bas). Quelle que soit la zone de vaccination, la campagne de vaccination a toujours été rapide et massive grâce à la mobilisation de la profession vétérinaire aux côtés des éleveurs et des services de l’Etat. A l’occasion des actes vaccinaux, les vétérinaires ont effectué une surveillance attentive de l’état de santé des bovins, en complément de la surveillance par l’éleveur de l’état de santé des animaux dont il a la charge et de la surveillance programmée dans les élevages en lien épidémiologiques avec les élevages foyers. Au 15 janvier, 814 suspicions de DNC ont été posées, réparties dans 52 départements (dont 91 suspicions réparties dans 41 départements en zone indemne). Ces nombreuses suspicions montrent la vigilance accrue de tous les acteurs, en zone réglementée comme en zone indemne et garantissent le contrôle strict de la maladie.
Bilan 2025 de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse en Catalogne
Dr Vét Marta DORDAS PERPINYA - ENVA
La crise de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) en Catalogne a débuté avec la détection du premier cas positif le 1ᵉʳ octobre 2025, le dernier cas ayant été confirmé le 22 octobre 2025. La campagne de vaccination a été mise en œuvre six jours après l’identification du premier cas. Celle-ci s’est déroulée de manière rapide et efficace, permettant d’atteindre environ 80 % de couverture vaccinale en l’espace d’un mois. Dans un second temps, le périmètre de vaccination et de surveillance a été étendu à l’ensemble de la moitié nord de la Catalogne afin de prévenir toute propagation secondaire de la maladie.
Diagnostic de laboratoire de la dermatose nodulaire contagieuse : outils disponibles et perspectives
Dr Bertrand SAUNIER - IPP, AvF
La dermatose nodulaire contagieuse (Lumpy skin disease) est une maladie virale bovine à déclaration obligatoire, causée par un capripoxvirus. Le diagnostic de laboratoire repose sur la détection directe du virus par PCR en temps réel, méthode de référence, ou par isolement viral et microscopie électronique. Les tests sérologiques (ELISA, séroneutralisation) permettent de suivre la circulation du virus et d’évaluer la réponse vaccinale, mais la distinction entre animaux infectés et vaccinés (principe DIVA) reste essentielle pour la surveillance. Les vaccins DIVA sont fondés sur des souches atténuées modifiées ou recombinantes permettant l’absence d’un ou plusieurs antigènes distinctifs. Les tests DIVA disponibles commercialement incluent principalement des PCR différentielles et quelques ELISA ciblant des protéines spécifiques absentes du vaccin. À ce jour, aucun test DIVA n’est officiellement homologué en France ou dans l’Union européenne, bien que plusieurs prototypes soient en validation (notamment au niveau de la FAO et de l’OIE/WOAH).
Identification de la pseudodermatose nodulaire en France
Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX - AVF, ENVA :
Depuis les premiers cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) observés en France le 29 juin 2025, les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation de cette maladie se sont avérées efficaces dans les deux départements de Savoie, dans les Alpes françaises. Cependant, des foyers épidémiques ultérieurs dans d'autres départements (Ain, Rhône, Jura), ainsi qu'en Catalogne (en Espagne) et dans les Pyrénées-Orientales, montrent que nous n'étions pas à l'abri des mouvements illégaux d'animaux avec le transport de bovins infectés vers des zones indemnes. L'augmentation des cas suspects de DNC dont les tests se sont révélés négatifs, même dans des zones géographiques indemnes et éloignées des foyers confirmés, a conduit à la première observation en France d'une pseudo-dermatose nodulaire contagieuse, une infection herpétique dont l’évolution est bénigne et qui n'aurait pas alerté les éleveurs en dehors du contexte de la DNC.